L’exode de 36 détenues de la Petite Roquette transférées à Libourne en juin 1940
Par Jacky Tronel | mercredi 5 mai 2010 | Catégorie : Dernières parutions, DES PRISONS… | 2 commentairesOn connaît l’exode des populations civiles qui, en mai-juin 1940, fuient le nord de la France et Paris dans la confusion la plus totale. L’exode pénitentiaire a été plus tragique encore ! Le 12 juin 1940, 36 prisonnières de la prison de la Roquette quittent Paris, en voitures cellulaires, pour un transfert qui les conduit à la prison de Libourne (Gironde)… Le 11 juillet, elles adressent une lettre collective de protestation au procureur de la République, à Paris. Ce témoignage éclaire un épisode peu connu de l’histoire pénitentiaire.

La rue Merlin longeant la prison de la Petite Roquette, au début du siècle. © Coll. Jacky Tronel.
« Libourne, 5 juillet 1940, Monsieur le Procureur de la République de Paris,
Nous venons par la présente protester sur la façon dont nous avons été évacuées et traitées depuis notre départ de Paris.
Étant 36 détenues prévenues de la Roquette, nous fûmes averties le 12 juin, à 9 h. du matin, de prendre nos affaires et de passer au guichet du greffe. Là on nous fit monter dans une voiture cellulaire, 2 par 2 par cellule, les bagages entassés dans le milieu de la voiture. On partit pour Fresnes. Arrivées là, on refusa de nous prendre, et comme on protestait du manque d’air et d’être serrées, un certain gardien nommé Robin monta dans la voiture et bouscula les femmes d’une façon malpropre, les menaça de leur donner des coups de pied si elles réclamaient quoi que ce soit et alors fit monter encore les familles des gardiens avec leurs bagages dans le milieu de la voiture.
Entassées nous partîmes enfin, et après 17 heures de route sans air dans une souffrance horrible, on arriva à Étampes à 1h.30 du matin. Nous fûmes reçues froidement comme de grands criminels. Ayant demander de l’eau, le gardien nous répondit de nous taire et de mettre notre langue dans la poche et notre mouchoir par-dessus ! On nous enferma dans des cellules noires et on nous obligea à laisser nos couvertures et affaires dehors. Au matin on quittait Étampes, sans manger et sans avoir fait la toilette, sans avoir bu une goutte d’eau et on se remettait en route pour Orléans, où on arrivait à 12 h. et où, à force de réclamations, on obtenait enfin le droit de boire un gobelet d’eau et d’aller au cabinet.
On repartait mais on revenait à la prison d’Orléans le soir à 19 heures, où on reçu une gamelle grasse. On ne pouvait la manger. On coucha sur la paille, et le lendemain 14 juin on se remettait en route pour Blois. Mais on ne nous laissa pas rentrer dans la prison. Toute la journée donc sur la route enfermées sans air, et toujours le couloir de la cellulaire rempli par la famille des gardiens. Les femmes se trouvaient mal, d’autres étaient obligées de se laisser aller dans leurs cellules. C’était affreux et inhumain.
Enfin on arriva à Tours vers 4 heures où le gardien chef de la prison reconnu notre état lamentable et ordonna de nous servir de suite la ration de ses prisonniers, que ces derniers pouvaient attendre, et qui consistait en une bonne gamelle de lentilles, 1 boule de pain blanc et 1/4 de vin. Pendant 1 heure on goûta le bienfait de cet homme humain, et on parti à regret.
On se remit en route pour Poitiers où on arriva à minuit toutes épuisées de fatigue. Là on nous mis à l’alignement et défense absolue de se plaindre ou de dire un mot. On nous mis dans un dortoir au grenier, dans le quartier des hommes, de 14 m. de long sur 4 m. où il y avait un entassement de paillasses. On se jeta dessus mortes de fatigue. Il y avait les tinettes infectes qui servaient aux 36 détenues. Des gamelles infectes nous furent servies pendant 2 jours. Impossible de les manger. On avait que le pain.
Le 17 on se remettait en route pour Angoulême. On arriva à 12 h. Sur de fortes protestations on nous fait descendre pour aller au cabinet. On nous enferma et pendant 2 heures, en plein soleil, on attendit que les gardiens et évacués soient revenus de faire leur repas. Nous les détenues on n’avait le droit qu’au cabinet et à un peu d’eau, pas plus.
On se remet en route, passons par Bordeaux pour Cadillac.On espère que c’est la dernière étape. Hélas. On arrive à 7 heures. Nous supplions de nous descendre. Des femmes sont malades. Une seule voiture descend pour leurs besoins. L’autre voiture reste fermée sous prétexte que l’on part de suite. L’on nous passe 1/4 de viandox et un peu de pain. Pendant ce temps, personnel et évacués se rationnent et en remontant dans la voiture toute la bonne chair qu’ils viennent de déguster devant les malheureuses affamées. On ne nous veut pas à Cadillac.
On repart pour Bordeaux. En route une femme se trouve mal et est obligée de prendre son masque à gaz pour ses besoins, n’étant pas descendue et étant restée 8 heures sans rien, déjà malade depuis le départ. Après une panne sur la route on arrive à 10 h. à Bordeaux. On nous enferme dans un dortoir sans manger, sans rien, et nous obligeant de laisser nos affaires dehors. Nous avons couché par terre ayant peu de paillasses et ces dernières étant remplies de vermine. Les gardiens étaient grossiers avec nous. Nuit d’alerte sous le bombardement. Le lendemain, 18 juin, on nous fit descendre. On nous remis une boule de pain et une gamelle d’eau grasse noire. Personne n’y toucha.
A 1 h.30 on repartait en direction de Périgueux. On resta 3 heures sur la route, en panne, à quelques kilomètres de Bordeaux. Une voiture fut obligée de partir et de faire escale à Libourne et de venir rechercher l’autre voiture restée en panne ! Bien nous en pris car malgré que l’on coucha sur la paille pendant notre séjour, les directeurs M. et Mme Beausoleil ont été très gentils, et ce sont les seules gamelles que l’on nous a servies que nous avons pu manger. Mais malheureusement, la fatigue, la maladie, le manque de tout… plusieurs femmes tombèrent malades.
Nos pécules étant restés à La Roquette, impossible de se remonter ou d’avoir un peu de supplément pour attendre. Voilà déjà 5 semaines que cela dure. Pourquoi avoir subi ce martyre ? Plus dur encore que des condamnées, souffrant de la faim, de la soif, de la fatigue, recevant encore des injures de la part de certains gardiens, tel que je cite ce passage, en passant par Châtellerault. Une alerte nous oblige de stopper sur la route. Les gardiens et les évacués descendent avec les chauffeurs pour se rafraîchir dans un café en nous laissant enfermées dans les cellulaires. C’est alors que le gardien René Bernadeau tint ses propos : “Les bombes peuvent tomber sur les voitures, car ce sont 2 voitures de P… et des loques”.
C’est pour cela, Monsieur le Procureur, que nous venons protester contre ce régime inhumain que nous avons subi depuis notre départ de La Roquette. Nous avons été évacuées alors que des femmes sont restées à La Roquette. Nous sommes ici à Libourne. Les Allemands y sont, tout comme à Paris. Nous ne voyons pas de raison d’avoir fait subir le martyr à des femmes qui ne sont pas jugées et dont il y en a qui n’ont pas encore de juge ! Nous tenons à signaler que Mme Patureau, gardienne à Fresnes, fut la seule à nous protéger et à prendre notre défense. Cette dame a toute notre reconnaissance.
Espérant, M. le Procureur, que vous nous donnerez satisfaction et que vous jugerez vous-même nos réclamations. Daignez recevoir nos respectueuses salutations Monsieur le Procureur et notre profonde reconnaissance. »

À l’angle de la rue Jules Ferry, la prison de Libourne. © Coll. Jacky Tronel.
Le 11 juillet 1940, le collectif adresse une nouvelle lettre de protestation au procureur de la République, à Paris.
« Monsieur le Procureur, Nous avons attendu encore croyant à une amélioration, ou à notre départ. Mais vraiment nous ne pouvons plus tenir. Nos forces s’épuisent. Nous couchons sur les mêmes bottes de paille depuis un mois dans la saleté. Nous n’avons même plus de savon. Cela devient de plus en plus intolérable.
Il y a des femmes qui sont innocentes Monsieur le Procureur. Est-ce juste ? Ce régime ne convient plus. Que l’on visite nos cellules. Que l’on nous interroge. On tombe malade, mais en prison. Il faut mourir.
Je vous assure Monsieur le Procureur, nous n’en pouvons plus. Nous vivons comme des bêtes, et encore les bêtes sont mieux que nous. Encore quelques jours et nous tomberont toutes. On nous a gardé notre argent. Pourquoi ? Cet argent est à nous. On ne peut se remonter au pain, et deux gamelles d’eau chaude ne suffisent plus. Nous sommes des prévenues. Les condamnées sont plus heureuses que nous. Car ici ces dernières sont libres, et nous, prévenues, on est enfermées ! Entassées par 7 dans une cellule d’une personne. »
Le 31 juillet 1940, le Procureur général près la Cour d’appel de Paris écrivait au Garde des Sceaux, lui demandant de « porter cette situation à la connaissance du Ministre de la Guerre qui paraît seul compétent pour donner à ces requêtes la suite qu’elles comportent. »
Le 4 octobre 1940. Le Garde des Sceaux, Ministre faisait cette réponse : « Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur la situation dans laquelle se trouvent, en zone occupée, certains individus, qui, poursuivis devant des juridictions militaires, sont actuellement encore en état de détention préventive. Certains de ces prévenus ont en effet sollicité leur mise en liberté provisoire, depuis le repliement en zone non occupée des juridictions devant lesquelles ils étaient poursuivis et des doutes se sont alors élevés sur le point de savoir si les juridictions de droit commun avaient qualité pour statuer sur ces demandes.
À cet égard, je crois devoir vous communiquer sous ce pli la copie d’un arrêt rendu le 27 septembre dernier, par la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d’Appel de Paris, qui, faisant application dans une hypothèse de cette nature de l’article 5 de la loi du 3 septembre 1940, a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu.
En conséquence, s’il se présente, dans votre ressort, des cas analogues, je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des Mises en Accusation de votre Siège des demandes de mise en liberté formulées par les détenus et faire déposer des conclusions tendant à ce que cette juridiction se déclare compétente pour statuer sur ces demandes. Vous voudrez bien, le cas échéant, m’adresser copie des arrêts qui interviendraient. »
Sources : Archives nationales, Paris, cote BB/18/3241/2/14.
Que sont-elles devenues ?
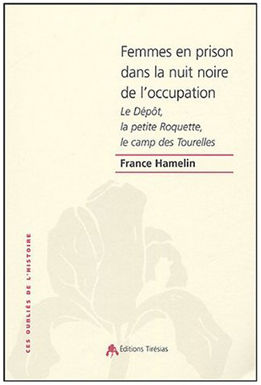 L’une de ces femmes, Marguerite Caudan, alias Margot Boisseau, témoigne dans le livre de la résistante France Hamelin : Femmes en prison dans la nuit noire de l’occupation – Le Dépôt, la petite Roquette, le camp des Tourelles, Éditions Tirésias, Paris, 2004.
L’une de ces femmes, Marguerite Caudan, alias Margot Boisseau, témoigne dans le livre de la résistante France Hamelin : Femmes en prison dans la nuit noire de l’occupation – Le Dépôt, la petite Roquette, le camp des Tourelles, Éditions Tirésias, Paris, 2004.
« Après deux ou trois semaines de répit à Libourne, nous voilà à Bordeaux, au Fort du Hâ, dans ses immenses salles en cul de basse-fosse. Nous avons été libérées fin juillet ou début août, je ne saurais trop dire dans quelles conditions. Je sais que des mères de familles emprisonnées avaient remué ciel et terre. Est-ce sur décision du directeur ne sachant sur quel pied danser dans la pagaille générale ? Est-ce une manœuvre démagogique de l’occupant comme il en a tenté plusieurs au début ? Toujours est-il que nous n’avons pas demandé notre reste, ni d’explication, de peur qu’on ne se ravise… Nous avons sauté dans le premier train brinquebalant en partance pour Paris. Nous nous sommes alors dispersées pour essayer au plus tôt de renouer les contacts et continuer le combat antifasciste. »

Du fait d’être simples prévenues, ces femmes devaient être d’autant plus révoltées par leur traitement. Avant et après elles, d’autres détenues, extraites elles aussi de la Petite-Roquette, connurent cela. En octobre 1939, une centaine de prisonnières de droit commun, étrangères raflées et prostituées, sont conduites au camp de Rieucros.
En septembre 1941, ce sont 46 détenues politiques qui sont transférées de la Roquette au Camp de Choisel. En tout, prêt de 4000 résistantes séjourneront dans les cellules de la Petite-Roquette. Chapeau bas pour des femmes telles que France Hamelin.
Merci pour cet article qui leur fait honneur.
Merci d’avoir, par votre commentaire, enrichi l’article… ainsi que pour la mention du site de La Roquette, Histoire du Quartier, Mémoire du Pavé..